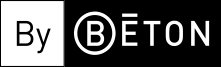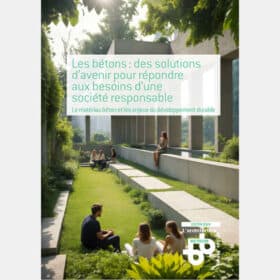Qu’est-ce que la construction durable ?
Définition et enjeux pour le secteur du bâtiment
La construction durable désigne l’ensemble des pratiques de conception, de réalisation et d’exploitation des bâtiments qui visent à limiter leur impact sur l’environnement, tout en répondant aux besoins actuels et futurs des occupants. Cela implique de prendre en compte l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, et de s’inscrire sous le prisme de la transition écologique.
Les enjeux sont multiples : réduction de l’empreinte carbone, maîtrise de la consommation énergétique, amélioration du confort de l’habitat et de la qualité de vie, adaptation au changement climatique…
Différence entre construction durable, verte et bas carbone
Tandis que la construction bas carbone s’attache à limiter les émissions de gaz à effet de serre, la construction verte tend à se concentrer sur l’efficacité énergétique et l’utilisation de ressources renouvelables. La construction durable englobe ces approches, tout en ajoutant des critères sociaux, économiques et territoriaux.
Les impacts environnementaux du secteur du bâtiment
Encadrer l’empreinte carbone de la chaîne de valeur du bâtiment
L’empreinte carbone de la chaîne de valeur du bâtiment représentait 153 Mt CO2e en 2019, soit 25 % de l’empreinte carbone annuelle de la France. Cela inclut l’ensemble des émissions liées à la construction, à la rénovation, à l’exploitation et à la fin de vie des bâtiments. Deux tiers de cette empreinte proviennent de l’exploitation des bâtiments, et un tiers des produits de construction et équipements.
Pour y remédier, la réglementation environnementale 2020 (RE2020) a notamment mis en place deux indicateurs carbone, encadrés par des seuils :
- l’Ic énergie évalue les émissions liées à la consommation d’énergie pendant l’utilisation du bâtiment, sur une durée de vie fixée à cinquante ans. Il dépend de la quantité d’énergie nécessaire et du type d’énergie (bois, gaz, électricité…) ;
- l’Ic construction évalue l’impact sur le changement climatique des composants du bâtiment et du chantier de construction. Il est calculé à partir des données environnementales disponibles sur la base INIES, par un logiciel spécifique.
Réduire l’impact des chantiers
Sur les chantiers, afin de réduire la consommation d’eau et d’énergie (alimentation des engins, éclairage, nettoyage…), plusieurs leviers existent : planification optimisée du chantier, choix des équipements et procédés, recours aux énergies renouvelables et logistique plus sobre.
De même pour la gestion des déchets. Provenant essentiellement de la démolition et de la rénovation, ces derniers sont valorisés en moyenne à plus de 50 % – un taux très variable selon leur provenance et leur type (inertes / non dangereux et non inertes). Plus de 70 % des bétons de déconstruction sont déjà valorisés. Pour accélérer la démarche, la déconstruction sélective, le tri à la source, le réemploi et la mise en œuvre de l’économie circulaire sont devenus des priorités.
A noter qu’il existe une charte Chantier propre : outre la gestion des ressources et des déchets, elle vise à limiter le bruit, prévenir la pollution de l’eau et des sols, réduire les émissions dans l’air…
Des solutions concrètes pour bâtir autrement
Choisir des matériaux éco-responsables
L’un des piliers de la construction durable est le choix des matériaux : le béton bas carbone et le béton de bois peuvent significativement réduire l’impact carbone d’un bâtiment (l’utilisation de biochar dans la formulation du premier permet d’ailleurs d’abaisser encore son empreinte).
Comme un béton classique, les bétons bas carbone ont aussi pour avantages leur résistance mécanique et leur comportement au feu. En raison de leur inertie thermique, ils peuvent également contribuer à la sobriété énergétique du bâtiment, notamment dans le cadre d’une architecture bioclimatique.
Ils permettent de développer pleinement une stratégie de mixité des matériaux, associés par exemple à des biosourcés (bois certifié, chanvre…). L’enjeu de tout bâtisseur sera donc d’arbitrer ses choix, en étudiant pour chaque matériau : sa disponibilité locale, ses propriétés pour les applications visées, mais aussi l’impact du climat local et des conditions d’exploitation du bâtiment sur ses performances et sa durabilité.
Intégrer les principes de l’économie circulaire
Appliquée au bâtiment, l’économie circulaire vise à réemployer ce qui peut l’être, et à recycler le reste. Cela signifie : concevoir des bâtiments facilement démontables, réutiliser des éléments de structure ou de second œuvre, valoriser les déchets inertes comme les granulats recyclés, gérer localement les flux et gisements de matériaux. Cette approche suppose une forte coopération entre maîtres d’ouvrage, architectes, entreprises, collectivités et filières de traitement.
De fait, la filière de tri des déchets du bâtiment se déploie progressivement, à travers la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs de produits et matériaux de construction, ou REP PMCB. Si cette REP fait aujourd’hui l’objet d’un moratoire et de travaux de refondation, la filière béton a d’ores et déjà contribué à la création de l’éco-organisme Ecominero pour aider les particuliers et professionnels à se défaire de leurs déchets : aujourd’hui, plus de 1100 plateformes de recyclage maillent le territoire, et le taux de recyclage des bétons de déconstruction dépasse les 70 % (soit 6,2 Mt).
Le béton est en effet totalement recyclable. En fin de vie, la partie métallique du béton armé est isolée, puis le béton est concassé pour être ensuite recyclé, soit en sous-couches routières, soit en granulats de béton recyclé (GBR). L’enjeu actuel est d’accroître la part de ces GBR dans la construction de bâtiments. Car le potentiel est là. Livré en 2024, Recygénie est par exemple le premier immeuble utilisant du béton entièrement recyclé (clinker, granulats, eau). A la clé, 3000 t de ressources naturelles économisées et 10 % d’émissions de CO2 en moins. Mieux : comme prouvé par le projet Fastcarb, les granulats de béton recyclé peuvent séquestrer durablement nos émissions de CO2 ; une qualité aujourd’hui exploitée à l’échelle industrielle par des acteurs tels que neustark.
Construire de manière plus sobre et efficace
Les techniques de construction hors-site (systèmes filaires 1D comme les poteaux et poutres, panneaux 2D, modules 3D prêts à l’usage) permettent d’utiliser la juste quantité de matière, de réduire les déchets et de mieux les gérer en usine, de diminuer la consommation énergétique des chantiers. Modulaires, elles permettraient aussi de bien anticiper certaines évolutions ou le démontage d’un bâtiment.
Parmi les acteurs de ce marché, la start-up Muance a développé un concept innovant de modules préfabriqués de 20 m2, en béton allégé et matériaux biosourcés, permettant de réduire de 60 % l’empreinte carbone des projets.
Dans la même logique, l’impression 3D permet de produire des éléments de structure sur mesure, rapidement, avec une grande précision et peu de déchets. Les initiatives dans ce domaine se multiplient : le bailleur social Plurial Novilia, après les maisons, expérimente l’impression d’immeubles en béton ; ou encore, la start-up Modulatio’ capitalise sur cette technologie pour créer des dalles et murs biomimétiques.
Par ailleurs, les outils de modélisation comme le BIM (Building Information Modeling) soutiennent et accélèrent l’ensemble de ces pratiques innovantes.
Toutes ces tendances sont complémentaires et s’inscrivent dans une dynamique d’industrialisation propre, au service d’une construction rapide, maîtrisée et respectueuse de l’environnement.
Réglementation et certifications pour une construction durable
Certains labels et certifications ont précédé les exigences de la nouvelle réglementation, d’autres y répondent ou les dépassent :
. Certification HQE : elle atteste de la qualité et de la performance environnementale globale du bâtiment, en croisant des critères d’écoconstruction, d’écogestion, de confort et de santé.
. Label BBCA : pionnier, il valorise les bâtiments à faible empreinte sur quatre axes : construction, exploitation, stockage du CO2 (biosourcés) et circularité (réemploi des matériaux et évolutivité du bâtiment).
. Label E+C- : ayant préfiguré la RE2020, il porte des exigences sur le critère énergie (E) – avec 4 niveaux de labellisation, allant jusqu’au bâtiment à énergie positive – et sur le crière carbone (C) – avec 2 niveaux, basé sur l’ACV des matériaux et des systèmes.
. Label Effinergie RE2020 : il est attribué aux constructions neuves dépassant les exigences de la RE2020 et propose deux niveaux de bâtiments à énergie positive (BEPOS et BEPOS+).
. Label PassivHaus : il valorise des bâtiments presque autonomes en énergie.
Il existe enfin des labels plus spécifiques : Bâtiment Biosourcé, Circolab (économie circulaire), WELL (bien-être), BiodiverCity (biodiversité)…
L’avenir de la construction durable : quels défis ?
Peut-on atteindre une construction 100% neutre en carbone ?
L’objectif est ambitieux et nécessaire, comme l’a rappelé Antonio Guterres en 2021 : « La volonté d’atteindre la neutralité carbone doit devenir la nouvelle norme pour tout le monde, partout. » Cela implique d’agir sur toute la chaîne de valeur :
- concevoir des bâtiments sobres et compacts ;
- utiliser des matériaux bas carbone et recyclés
- s’appuyer sur les énergies renouvelables ;
- réduire la consommation énergétique des usages ;
- favoriser la déconstruction et le réemploi.
Mais même les meilleures pratiques laisseront une part incompressible d’émissions. La neutralité de la construction devra aussi passer par des mécanismes de compensation : séquestration carbone, reforestation, sols vivants…