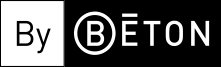Appelé parfois « le balcon de Genève », le mont Salève se situe en Haute-Savoie, à la frontière franco-suisse. Il surplombe le Genevois et tout le bassin lémanique. Longtemps réservé aux marcheurs aguerris, il connut un surcroît d’affluence avec la construction d’un train à crémaillère en 1892, remplacé en 1932 par un téléphérique. Conçu par l’architecte suisse Maurice Braillard en collaboration avec les ingénieurs Georges Riondel et André Rebuffel, ce dernier relie une gare haute moderniste : morceau de bravoure implanté à l’aplomb du vide à 1 100 m d’altitude, le bâtiment-pont en béton armé laissé brut de décoffrage balise depuis lors le paysage.
Un patrimoine architectural à redynamiser
En près d’un siècle, le lieu connut des transformations plus ou moins heureuses. En 2013, d’importants travaux de mise en sécurité furent engagés et une étude globale aboutit à la décision d’une réhabilitation-extension de l’équipement. Un choix sans doute motivé par le fait qu’il offre un accès rapide non seulement à un spot de parapente, d’escalade et de randonnées, mais aussi à un site du réseau Natura 2000.
L’inscription du téléphérique au titre des Monuments historiques en 2018 conforta la décision de valoriser ce patrimoine architectural et technique. « Quand nous avons gagné le concours, en 2018, la valeur patrimoniale du bâtiment n’était pas encore prise en compte, indique Claudia Devaux, architecte spécialiste du patrimoine du XXe siècle et des pathologies du béton, associée de l’agence DDA Devaux & Devaux Architectes. Le projet initial n’avait pu être mené à son terme : la salle panoramique inachevée était restée exposée aux intempéries, le restaurant et l’hôtel n’avaient pas été réalisés. Par ailleurs, les interventions ultérieures avaient plutôt dégradé le bâtiment et son environnement. »
Le béton comme fil conducteur
Sans chercher à achever le projet d’origine mais en s’appuyant sur les archives de la fondation Braillard, les architectes se sont attachés à retrouver le rapport à la vue en supprimant les ajouts qui encombraient le site et à maintenir le rapport au vide. Leur projet s’inscrit dans la continuité de l’édifice construit dans les années 1930, sans s’interdire un apport contemporain. L’utilisation du béton, et la distinction subtile de couleur entre le bâtiment d’origine rénové et l’extension en témoignent.
L’extension s’appuie en partie sur les fondations existantes, poursuivant les niveaux haut et bas vers l’arrière comme pour mieux arrimer l’ensemble. Certains locaux ont été modifiés, notamment le niveau haut, qui a été transformé en restaurant panoramique, comme l’avait prévu Maurice Braillard, et prolongé par une salle de séminaire.
Des espaces ont été créés pour accueillir les nouveaux services, notamment la grande salle d’exposition, posée sur le sol et entièrement vitrée. Cette extension transversale basse rejoint, de l’autre côté du bâtiment-pont, la nouvelle tour-escalier, singularisée par un mur pignon ouest de 22 m de hauteur, équipé en mur d’escalade.
Retrouver l’aspect brut du matériau
L’intervention sur le bâtiment-pont, outre l’aménagement et le réaménagement des différents espaces, devait d’une part répondre à la nécessité de le rendre conforme aux normes actuelles, y compris sismiques, et, d’autre part, lui rendre son aspect brutaliste d’origine. « Les bétons des années 1930 étaient poreux, mal vibrés mais, à l’exception des poutres du restaurant, ils présentaient peu de corrosion car les fers étaient bien enrobés, raconte Claudia Devaux. Nous avons voulu retrouver l’aspect brut du matériau qui avait disparu lors des travaux du début des années 1980 sous 3 à 5 cm d’épaisseur de béton projeté, amollissant l’architecture d’angle de Braillard. » Enlever ce béton projeté, très dur, sur celui d’origine, plus tendre, a demandé un travail long et délicat de décroûtage.
Entre la diversité des points de vue et l’espace d’exposition, la station haute du Salève se trouve enrichie d’outils de compréhension permettant d’appréhender la richesse d’un environnement vivant à préserver.