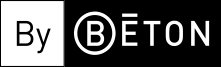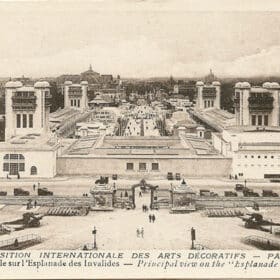L’année 2025 a bien commencé pour la Philharmonie de Paris ! Début janvier, un public fidèle de mélomanes de tous âges a pu souffler ses 10 bougies avec les chefs Gustavo Dudamel et Simon Rattle, le rappeur Prince Waly et une « nuit électro ». Une programmation éclectique qui forge l’identité de la Philharmonie depuis son inauguration, le 14 janvier 2015, tout comme son étonnant bâtiment scintillant, se dressant comme une troisième colline – avec Montmartre et les Buttes-Chaumont – dans le paysage du nord-est parisien.
Une géométrie très complexe
La genèse de la Philharmonie débute le 6 mars 2006, lorsque le ministre de la Culture de l’époque lance le projet d’un haut lieu musical dans le Parc de la Villette et, dans la foulée, un concours international de maîtrise d’œuvre. 98 équipes participent, mais c’est le projet des Ateliers Jean Nouvel qui emporte le concours.
Leur bâtiment associe béton armé et métal. Il culmine à 52 mètres et présente une géométrie très complexe : en son cœur, une spirale d’aluminium brillant s’enroule autour de la salle de concert centrale ; un élément fort, complété par une enveloppe anguleuse et asymétrique, d’aspect mat. Sur 20 000 m2, le complexe offre aux musiciens et au public son exceptionnelle salle de concert, des salles de répétition, un studio, un vaste centre éducatif, un espace d’exposition, des bureaux, toutes les infrastructures nécessaires aux équipes logistiques et techniques, deux niveaux de parking… et un restaurant au dernier étage, L’Envol.
Une rampe en béton armé s’élève en pente douce depuis la porte de Pantin et rejoint le hall de la grande salle. En poursuivant l’ascension jusqu’au belvédère, à 37 mètres de haut, les visiteurs jouissent d’une vue panoramique sur le parc de la Villette, Paris et sa banlieue.
Des oiseaux et des nuages
Symbole de légèreté, poésie et musique, le motif principal des façades est l’oiseau. La Philharmonie est recouverte d’un bardage composé de 265 000 oiseaux en fonte d’aluminium : sept formes déclinées en quatre teintes, du gris clair au noir, permettent de recomposer leur nuée au gré de la lumière naturelle. Habillant le parvis, la rampe d’accès et une partie de la toiture, 65 000 autres compères rejoignent leur murmure.
Mais le cœur battant du lieu, c’est la Grande salle Pierre Boulez. Selon la formation musicale invitée, elle peut accueillir 2 400 fauteuils ou 3 500 places debout. En configuration symphonique, l’orchestre est placé au centre ; en mode jazz, il peut se retrouver au fond. Dans cette salle modulable et enveloppante, le siège le plus éloigné se situe à 32 mètres du chef d’orchestre, et le temps de réverbération est de 2,3 secondes ! Une acoustique exceptionnelle à laquelle ont contribué deux stars du domaine, le Néo-Zélandais Sir Harold Marshall et le Japonais Yasuhisa Toyota (Nagata Acoustics).
L’espace est composé de deux enveloppes imbriquées : l’une contient dans une belle intimité l’orchestre et les auditeurs sur les balcons, l’autre constitue le contour extérieur. Décoller les balcons des parois extérieures permet de maintenir les spectateurs à distance d’un mur de fond et de les envelopper par le son. Nuages, plaques, bandes… réfléchissants ou amortissants s’ajoutent pour moduler le son – notamment un grand nuage central réglable en hauteur -, sans oublier le rôle des balcons asymétriques dans le dispositif.
Les pouvoirs isolants du béton
Distante de 350 mètres seulement, une centrale a fourni les 50 000 m3 de béton mis en œuvre dans la Philharmonie depuis les fondations jusqu’aux balcons. Différentes formulations – pas moins de 50 – ont répondu aux multiples exigences du projet, notamment acoustiques.
La Philharmonie étant édifiée aux abords immédiats du boulevard périphérique, un double voile de béton avec un vide entre les parois assure l’insonorisation de la Grande salle, selon le concept de « la boîte dans la boîte ». Le bruit de fond maximum autorisé était de 15 décibels audibles ; la performance acoustique obtenue atteint le niveau NR10. Une double toiture en béton complète le système.
Pour optimiser les étapes d’un tel chantier, une maquette numérique de l’ouvrage a été conçue, et la méthode BIM (Building Information Modelling) s’est avérée un outil précieux, en particulier pour la réalisation des toitures inclinées à 30 % qui ont nécessité une soixantaine de poutres et de lourdes dalles préfabriquées.
Les ambitions d’un directeur heureux
Aujourd’hui, la Philharmonie de Paris affiche un taux de remplissage de 92 % : « C’est une des salles les plus fréquentées au monde par les artistes », se réjouit son directeur général Olivier Mantei. Fier d’une hausse de 17 % de la billetterie et de 65 % du mécénat l’an dernier, il souhaite progresser encore en matière d’accessibilité, de diversité, d’éco-responsabilité et d’égalité. Féminisation des pupitres, nouveau festival de création-composition et d’expérimentations musicales, ou projet d’école supérieure pour former les managers aux métiers de la musique : les chantiers ne manquent pas ! Pour le directeur général : « Une génération Philharmonie est apparue, composée des premiers spectateurs de la Cité de la musique, des millions d’enfants qui ont fréquenté les ateliers éducatifs et que nous retrouvons dans nos concerts et nos expositions. »