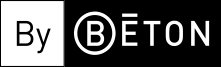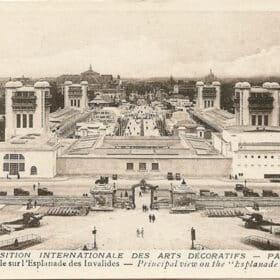Il y a 100 ans…
Au sortir de la guerre de 1914-1918, André Honnorat, ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, et Paul Appell, recteur de l’Université de Paris, déplorent les conditions de vie des étudiants dans la capitale. Ils forment alors le projet d’une résidence universitaire qui réponde à leurs idéaux hygiéniste, pacifiste et multiculturel. Au sud de Paris, le secteur des anciennes fortifications est choisi : 9 hectares seront attribués à cette résidence, le reste deviendra un grand parc. En 1921, une convention est signée et, en 1925, la première maison – financée par l’industriel Deutsch de la Meurthe – ouvre ses portes à 350 étudiants méritants et peu fortunés. Il s’agit de la Fondation Deutsch de la Meurthe.
Une évolution très rapide
En moins de quinze ans, avec l’aide d’une poignée de mécènes, d’écoles et de gouvernements étrangers, 19 autres maisons sont construites, dans des styles régionaux très éclectiques. A la veille de la Deuxième Guerre mondiale, 52 nationalités sont représentées, la surface du domaine passe à 40 hectares, et la hauteur des immeubles de 4 à 10 étages. Occupée par les Allemands pendant le conflit, puis par les Américains à la libération, la « Cité U » retrouve son état d’avant-guerre à la fin des années 1950 et s’enrichit de 17 nouvelles maisons durant la double décennie 1950-1960. Toutefois, la construction du périphérique marque la fin de son expansion et le début d’une Cité « hors les murs ». Ainsi les résidences Lila et Quai de la Loire ont été inaugurées au cours des années 2000 dans le XIXe arrondissement. Avec Cité 2025, un nouveau projet d’aménagement relance pourtant la construction de 10 maisons dès 2013, ainsi que la requalification et l’agrandissement du parc.
La Cité U et le béton, une histoire constructive
Aujourd’hui, la Cité U accueille chaque année 12000 résidents de 150 nationalités. Au fil des ans, l’architecture des maisons s’est inspirée de la culture de chaque pays ou a reflété l’avant-garde, en pierre, brique, ardoise ou bois. La cité offre un panorama architectural des XXe et XXIe siècle, et témoigne ainsi du rôle joué par le béton et ses évolutions. Visite de quelques chefs-d’œuvre de ce musée à ciel ouvert…
La Fondation suisse. En 1933, le pavillon suisse est le premier habitat collectif signé par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Il illustre parfaitement les 5 points de l’architecture moderne qu’ils ont théorisés en 1927 : une maison sur pilotis en béton armé brut de décoffrage, un plan libre, une façade libre (indépendante de la structure) en pierre reconstituée, des fenêtres en bandeaux et un toit-terrasse. Avec la préfabrication industrielle des étages, les recherches sur l’isolation phonique, l’aménagement étudié des chambres (avec Charlotte Perriand). ce pavillon a été le laboratoire privilégié des deux architectes. Une grande réussite pour Le Corbusier qui souhaitait « qu’à Paris, la Suisse apparût autrement que sous les visages agrestes du poète : un chalet et des vaches ». Le bâtiment a été classé monument historique en 1986.
Le Collège néerlandais. Inspiré par le mouvement De Stijl, ce bâtiment illustre le courant moderniste des années 1920 et l’architecture industrielle. Willem Marinus Dudok a emboîté des volumes cubiques percés de baies horizontales et dominés par une tour semblable à un beffroi : l’ossature est en béton armé, recouverte d’un enduit. Inauguré en 1938, le bâtiment a été classé monument historique en 2005 et entièrement rénové entre 2011 et 2016.
La Maison du Brésil. Près de trente ans après la Fondation suisse, Le Corbusier achève en 1959 une autre œuvre phare du XXe siècle : la Maison du Brésil, fruit d’une collaboration houleuse avec le Brésilien Lucio Costa. Côté est, le bâtiment principal est une barre d’immeuble de cinq étages. À la manière de ses unités d’habitation, Le Corbusier reprend le principe des pilotis de béton surmontés de poutres et la façade est traitée en loggias à claustra en béton, qui sont peintes aux couleurs du drapeau brésilien. Un bâtiment bas, côté ouest, accueille les espaces de rencontre : théâtre, salles d’exposition et de réunion. Cette maison témoigne de la période brutaliste du Corbusier : le béton conserve ses traces de coffrage. Inscrite au titre des monuments historiques en 1985, elle a été restaurée de 1997 à 2000, puis en 2019.
La Maison de la Corée. Inaugurée en 2018, la Maison de la Corée a été la première maison construite au sein de la cité depuis la pause de 1969. Entre parc et périphérique, le plan en « V » largement ouvert de ses façades de huit étages associe les bétons blanc et gris. « On se devait de construire en béton », commente Pierre Boudon, de l’agence Canale 3 (co-architecte avec Ga.a), qui pointe la proximité des grandes œuvres du Corbusier.
Construite sur d’ancienne carrières, à proximité du RER, l’infrastructure – coulée sur place – est composée de voiles de béton et de pieux de 25 m soutenant une superstructure composée de poutraisons en béton armé reposant sur des boîtes à ressorts.
Les trois façades sont différentes, chacune adaptée à son environnement. Sa façade nord-est, orientée sur le parc, consiste en une paroi ondulante entièrement vitrée et balconnée. Plus exposée aux nuisances du périphérique tout proche, la façade ouest est monolithique, composée d’éléments préfabriqués en béton poli à partir d’agrégats de marbre blanc. Côté sud, face au boulevard, une double peau composée de brise-soleil et de coursives renforce l’isolation thermique et acoustique. Cette façade est recouverte de panneaux préfabriqués en béton blanc dépolluant : grâce à l’effet photocatalytique de particules de dioxyde de titane, au contact de la lumière, leur surface blanche et lisse décompose les substances gazeuses et les composés organiques volatils présents dans l’atmosphère.
La Maison des étudiants de la francophonie. Cette maison des étudiants et des chercheurs du monde francophone a ouvert ses portes en 2021 : 300 logements sur une superficie de plus de 7000 m2. Sa silhouette « en proue », constituée d’éléments préfabriqués de béton gris clair sablé, impose sa grande masse face au périphérique. L’agence Baumschlager Eberle Architekten a joué avec des éléments biseautés pour modeler le relief des façades et créer des jeux d’ombre. La structure du bâtiment permet de l’adapter aux usages et besoins futurs en supprimant les cloisons et en transformant par exemple des pièces individuelles en logements doubles ou entiers. Quant à l’isolation, les architectes expliquent que « l’utilisation du béton avec ses propriétés isolantes comme matériau de construction principal atténue encore les apports acoustiques ». La construction répond également aux critères de performance énergétique avec des besoins de chauffage inférieurs de 25 % à ceux d’un bâtiment RT2012.
La Maison d’Égypte. Entièrement financée par l’Égypte, elle a été conçue par Sam Architecture et Dar Arafa Architecture sur un terrain de 1915 m2. Ses premiers résidents ont été accueillis début 2024. Sur huit niveaux, la maison est construite autour d’un atrium et propose 185 chambres, 7 studios, 3 appartements T2 et un centre culturel. La façade préfabriquée en béton ocre et sablé reprend les codes monolithiques des constructions pharaoniques. Deux murs pignons sont gravés en hiéroglyphes d’anciens textes traitant de la quête du savoir, comme la prière à Thot et la profession de foi d’un scribe. Ses jardins intérieurs et extérieurs sont plantés d’essences de la vallée du Nil.
Avec ses 10 nouvelles maisons, soit 1800 logements supplémentaires, le projet Cité 2025 relance indéniablement le développement de la cité internationale. Ce centenaire n’est pas seulement une commémoration, mais aussi une invitation à imaginer l’avenir. De génération en génération, les architectes de la Cité-monde ont dessiné les conditions du « bien vivre ensemble ». Un esprit de paix qui inspire toujours cette centenaire ô combien dynamique.