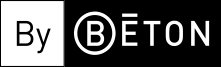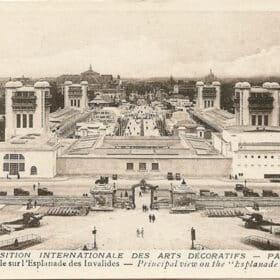À la tête d’une immense fortune, Eli Broad (1933-2021) et son épouse Edythe ont collectionné avec passion, depuis les années 1970, l’art contemporain américain de l’après-guerre. Avec un goût très sûr, ils ont acquis plus de 2000 œuvres, souvent auprès d’artistes encore peu connus. C’est ainsi qu’ils ont acheté 150 dollars pièce les premières photographies de Cindy Sherman, qui s’arrachent aujourd’hui à plusieurs millions de dollars dans les salles des ventes, et, pour quelques milliers de dollars, des toiles de Jean-Michel Basquiat.
Au fil du temps et des visites d’ateliers, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Cy Twombly, Keith Haring, Robert Rauschenberg, Damien Hirst, Jeff Koons… plus de 200 artistes sont entrés dans la collection. Homme d’affaires avisé et joueur, Eli Broad aimait dire : « Nous ne savions pas ce qui se passerait avec Basquiat ou Haring quand nous les avons achetés. »
Les Médicis de Los Angeles
Mécènes et philanthropes, Eli et Edythe Broad ont souhaité offrir un cadre à leur collection et l’ouvrir au plus grand nombre. C’est ainsi qu’est née l’idée de The Broad : un musée et le siège de leur fondation.
Ce projet a encore davantage justifié le surnom californien d’Eli Broad – le « Laurent de Médicis de Los Angeles » –, et Edythe s’est engagée passionnément dans sa mise en œuvre. Un concours d’architecture a désigné comme lauréate Elizabeth Diller, de l’agence new-yorkaise Diller Scofidio + Renfro, célèbre entre autres pour avoir transformé en promenade la High Line de New York.
Le site choisi pour l’implantation du musée est un ancien parking sur Grand Avenue, tout près du Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry (2003), dans un quartier alors démodé du centre-ville.
Faire entrer la lumière au musée
Inauguré en 2015, The Broad Museum comporte un bâtiment carré d’une superficie d’un peu plus de 11 000 m2. Il est enveloppé par une carapace blanche de béton renforcé de fibre de verre : le voile.
Cet exosquelette de béton alvéolé, dont la façade aux 318 ouvertures est profondément incurvée autour d’un grand oculus, filtre la lumière naturelle.
Un point essentiel pour les Broad qui l’avaient inscrit dans leur cahier des charges : « Nous ne voulons pas que ce musée soit sombre. La plupart des musées sont noirs et inhospitaliers. Pas celui-ci. »
Le voile et la voûte
16 000 tonnes de béton ont été mises en œuvre au Broad Museum. 2 500 panneaux aux courbes différentes ont été préfabriqués pour réaliser le voile. Souple et polyvalent, le béton était parfaitement adapté pour créer cette forme dont la conception a débuté par des modèles informatiques tridimensionnels. Il a permis de donner un mouvement au bâtiment, qui se relève dans les angles nord et sud pour accueillir les visiteurs dans le hall d’entrée.
Ce voile enveloppe l’intérieur du musée, constitué de ce qui est appelé la « voûte ». Grande masse opaque presque en lévitation, celle-ci fusionne les deux fonctions d’un musée : l’espace d’exposition publique et les vastes réserves de la collection.
Depuis le hall, en arrivant sous la voûte, le public emprunte un escalator qui la traverse jusqu’à la galerie d’exposition, au troisième étage, dont le plafond culmine à 7 mètres de hauteur.
Les visiteurs quittent ce troisième étage par un escalier central sinueux, qui traverse de nouveau la voûte et offre un aperçu des réserves, car Elizabeth Diller souhaitait « rendre les fonctions de conservation visibles au premier plan, plutôt que de les cacher comme dans la plupart des musées ».
L’âge d’or californien des collections privées
En 2015, David Pakshong, l’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre n’en revenait pas : « Après quatre ans de travail sur le bâtiment, je suis toujours surpris par la capacité de l’architecture à remettre en question la façon dont nous comprenons l’espace. »
Aujourd’hui The Broad a pris toute sa place dans l’écosystème de Los Angeles. Il attire un public nombreux et génère une manne économique importante pour la ville.
Aucun doute, The Broad Museum a rejoint le groupe très select des musées « éponymes » de Los Angeles : Armand Hammer, J. Paul Getty ou Norton Simon, qui participent à un nouvel âge d’or californien des collections privées.