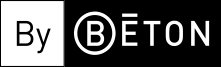Pour quelles raisons la mairie de Montpellier a-t-elle souhaité restructurer ce lieu ?
Adrian Garcin : Le Centre d’expérimentations et d’innovation sociale (CEIS) est le premier tiers-lieu social et numérique de Montpellier conçu pour les citoyens. Il se substitue à une ancienne crèche des années 1950. La restructuration et l’extension du bâtiment visent à faire émerger un équipement pluriactivités : un lieu très social, avec des ateliers ouverts aux habitants du quartier – ateliers numériques, artistiques, activités de réinsertion, etc. Il s’adresse notamment aux personnes en situation fragile, qui viennent refaire leur CV, se former aux outils informatiques… C’est un bâtiment de proximité, de mixité sociale, un vrai trait d’union entre Figuerolles et les Arceaux, deux quartiers assez différents de Montpellier.
Comment avez-vous repensé le programme pour répondre aux futurs usages ?
AG : Nous avons conservé les deux bâtiments en pierre sur rue, qui ont fait l’objet d’une restauration lourde : renforcement des planchers, réfection complète des toitures, charpentes, couvertures, ravalement des façades. Et nous avons remplacé les extensions des années 1950, amiantées et de faible intérêt patrimonial, par une construction neuve qui en reprend la volumétrie. L’enjeu principal était de libérer le cœur d’îlot pour révéler le jardin. Cette extension en équerre, très ouverte, articule les différents pôles d’activité – ateliers, épicerie solidaire, services – et crée une vraie cohérence spatiale autour de ce grand espace paysager.
La singularité du projet réside dans la réalisation de planchers à voûtains en béton pour l’extension, qui était une première pour vous…
AG : Les voûtains sont effectivement un élément fort du projet. C’est une technique ancienne que l’on retrouve souvent en Méditerranée, en Catalogne, à Marseille… Généralement en brique. Ici, nous l’avons réinterprétée en béton. L’idée était de s’inspirer de l’aqueduc des Arceaux tout proche, avec ses grandes arcades. Ces voûtains, en plus d’apporter une nouvelle identité au lieu, présentent de vraies qualités techniques : ils génèrent des espaces clairs, lisibles, propices à une bonne acoustique. Leur inertie thermique contribue au confort d’été, et leur géométrie donne du caractère aux volumes tout en facilitant l’éclairage naturel. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’entreprise Darver pour mettre au point un prototype. Le coffrage en bois, basé sur un mannequin unique, a permis un coulage en place efficace. Le béton est utilisé pour les poteaux, les dalles, certaines façades arrière… Il reste brut, apparent, et crée un contraste intéressant avec le bois. Nous avons aussi de grandes baies vitrées et des murs-rideaux en bois en rez-de-chaussée. Cette écriture contemporaine dialogue avec l’existant.
Quelles réponses avez-vous apportées aux enjeux environnementaux ?
AG : Le projet s’appuie sur une démarche bioclimatique : compacité, protections solaires passives, ventilation naturelle, choix de matériaux durables. Nous avons travaillé avec les paysagistes de l’agence Toponymy pour valoriser l’existant, réemployer les dalles de l’ancienne cour, désimperméabiliser les sols. Les façades en bois sont protégées par de larges débords, et une surface photovoltaïque de 110 m² en toiture contribue à viser un bâtiment proche des standards BEPOS. Aujourd’hui, l’ossature est en place, les voûtains sont coulés, les façades posées. La livraison est prévue à l’automne 2025.